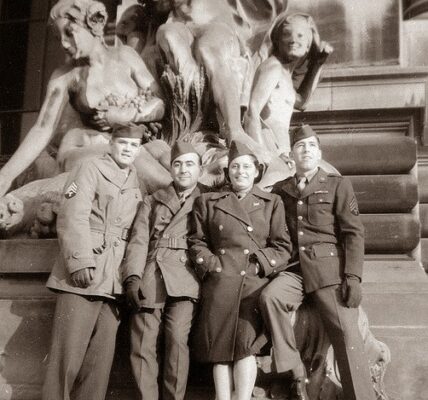Des spectateurs grimpent sur des meubles pour assister à la signature du Traité de Versailles, 1919 .hh

Des officiers militaires et des hommes politiques grimpent sur les meubles pour assister à la signature du traité de Versailles au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1919.
Le 28 juin 1919, le traité de paix mettant fin à la Première Guerre mondiale est signé par l’Allemagne et les Alliés au château de Versailles, près de Paris. Les intérêts alliés sont représentés par les « Trois Grands » : le Premier ministre britannique David Lloyd George, le Premier ministre français George Clemenceau et le président américain Woodrow Wilson.
La Grande Guerre avait dévasté l’Europe. De vastes régions du nord-ouest de l’Europe étaient réduites à l’état de paysages lunaires ; des villages et des villes françaises et belges avaient disparu sans laisser de traces. Le conflit avait décimé la population masculine européenne.
Les deux camps ont subi des pertes d’une ampleur presque incompréhensible. La France a subi plus de 1,4 million de morts et plus de 4 millions de blessés. Au total, 8,5 millions d’hommes ont péri.
Selon le traité, l’Allemagne était dépouillée de 13 pour cent de son territoire et de 10 pour cent de sa population ; les territoires frontaliers de l’Alsace et de la Lorraine étaient restitués à la France.
L’Allemagne perdit toutes ses colonies, 75 % de ses gisements de minerai de fer et 26 % de ses réserves de charbon et de potasse. La taille de l’armée et de la marine fut considérablement réduite, et l’aviation et les sous-marins furent interdits. Les Allemands durent également accepter officiellement leur « culpabilité de guerre » et payer des réparations.
Compte rendu de Sir James Headlam-Morley sur la signature : « Il y eut très peu de cérémonie et de dignité. Les plénipotentiaires entrèrent tous tranquillement avec la foule… Quand ils furent tous assis, les délégués allemands furent introduits ; ils passèrent près de moi ; ils ressemblaient à des prisonniers amenés pour être jugés… »
Les Allemands signèrent les premiers, puis tous les autres délégués… La signature terminée, la séance fut levée et les Allemands furent reconduits dehors comme des prisonniers qui avaient reçu leur sentence.
Personne ne s’est levé ni n’a prêté attention à eux, et rien n’indiquait qu’une fois la paix signée, un changement d’attitude allait être amorcé. Rétrospectivement, l’impression générale me semble, d’un point de vue politique, désastreuse…
En réalité, ce qui se passait réellement n’était pas simplement de faire la paix avec l’Allemagne, mais de signer le Pacte de la Société des Nations, mais personne ne semblait y penser… Il manquait tout simplement la note nécessaire de réconciliation, d’espoir, de changement de point de vue.
Le résultat de ces objectifs concurrents et parfois contradictoires entre les vainqueurs fut un compromis qui ne laissa personne satisfait : l’Allemagne n’était ni pacifiée, ni conciliée, ni affaiblie de manière permanente.
Les problèmes découlant du traité ont conduit aux traités de Locarno, qui ont amélioré les relations entre l’Allemagne et les autres puissances européennes, et à la renégociation du système de réparations qui a abouti au plan Dawes, au plan Young et au report indéfini des réparations lors de la conférence de Lausanne de 1932.